« Les enjeux juridiques constituent l’une des composantes que les dirigeants devraient prendre en compte dans la définition de la stratégie extra-financière de la tête de réseau », estime l’auteur, avocat, qui explique comment les directions juridiques peuvent y contribuer.
 Par Christophe Grison, Avocat d’affaires, FIDAL
Par Christophe Grison, Avocat d’affaires, FIDAL
La mise en place d’actions en matière de durabilité peut nécessiter d’adapter la gouvernance de la tête de réseau afin de prendre en considération l’ensemble des enjeux liés à ses activités. Parmi ces enjeux, les enjeux juridiques constituent l’une des composantes que les dirigeants devraient prendre en compte dans la définition de la stratégie extra-financière de la tête de réseau.
Les directions juridiques et/ou leurs conseils peuvent, en effet, accompagner la tête de réseau dans ses choix stratégiques en apportant certaines informations primordiales à la prise de décisions de la direction générale selon l’évolution du cadre juridique et suivant trois niveaux d’intervention décrits ci-dessous :
– 1ère niveau : une mise en conformité du réseau aux obligations légales et règlementaires : à ce stade, il s’agit de rédiger et d’adapter la documentation contractuelle (ex. : charte éthique, contrat de franchise, règlement intérieur, statuts de la coopérative etc.). L’objectif poursuivi par la direction juridique est d’éviter les sanctions légales et financières, le cas échéant, liées à l’adoption de ces nouvelles obligations ce qui peut nécessiter une évolution du savoir-faire sachant que d’éventuelles tensions avec certains distributeurs ne souhaitant pas ou ne pouvant pas réaliser les investissements demandés devront être gérés (cf. notre 1er épisode) ;
– 2ème niveau : une analyse prospective de la législation nationale et communautaire : il s’agit d’anticiper les évolutions législatives et règlementaires et d’envisager certaines actions permettant de devancer une prochaine législation ou bien à l’inverse, d’écarter certaines évolutions qui auraient peu de chances de prospérer en l’état. La tête de réseau a davantage de latitude dans ce 2ème niveau que dans le cadre d’une simple mise en conformité (1er niveau) afin de définir et tester les actions extra-financières qu’elle envisage de mettre en place au regard des probables évolutions règlementaires. La validation de telles actions devrait permettre de faire évoluer le savoir-faire de l’enseigne mais également de se distinguer de ses concurrents tout en recherchant des solutions sauvegardant la performance des points de vente. Ainsi, la loi AGEC n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire visait à ce que les consommateurs puissent acheter en vrac certains produits. Il s’agissait d’une pratique commerciale dite « encouragée ». En pratique, la mise en place de la vente en vrac implique notamment de repenser la livraison des produits, de mener une réflexion sur leurs conditionnements avec les fournisseurs, d’adapter et de former les équipes aux conditions d’hygiène en magasin. La loi prévoit d’ailleurs que d’ici 2030 les commerces de vente au détail de plus de 400 m² devront consacrer à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation. Cela signifie une évolution du savoir-faire de l’enseigne, et même de son concept, avec la nécessité de démontrer que cette évolution vers le vrac (et les investissements qu’elle implique) permettra aux distributeurs d’être au moins aussi rentable qu’avec le concept actuel ;
– 3ème niveau : la direction juridique et ses conseils, avec le soutien de fédérations professionnelles, peuvent mettre en place une veille permettant de prendre en compte des législations nationales ou communautaires non votées ou des rapports rédigés par des groupes de lobby qui pourraient constituer un nouveau cadre normatif à respecter. Autrement dit, ce 3ème niveau permet à la tête de réseau d’appréhender les tendances possibles des évolutions législatives : ces tendances pouvant constituer des opportunités permettant de se différencier de la concurrence en prenant un temps d’avance sur le législateur ou bien au contraire constituer d’éventuels freins pouvant impacter le modèle d’affaires de la tête de réseau ce qui peut amener à imaginer des solutions alternatives qui permettront d’éviter l’adoption de telles mesures.
Ces deux derniers niveaux d’intervention nécessitent des échanges en interne avec les différentes fonctions de l’entreprise et avec les parties prenantes concernées par l’évolution du cadre législatif afin de prendre en considération l’ensemble des points de vue.
Ainsi, la direction générale pourra définir les actions à mettre en œuvre au sein du réseau en prenant en compte la dimension juridique – au côté de la dimension financière et opérationnelle – et fédérer ses parties prenantes autour d’objectifs extra-financiers – et financiers – qu’elle aura définis dans une démarche systémique et qui feront parties intégrantes de sa stratégie.
La direction juridique, accompagnée par ses conseils, pourra utilement accompagner les équipes de la tête de réseau dans la mise en œuvre de ses objectifs et apporter une haute valeur ajoutée sur des sujets qui n’ont parfois pas encore été traités et qui laissent davantage place à l’ingénierie juridique et fiscale.
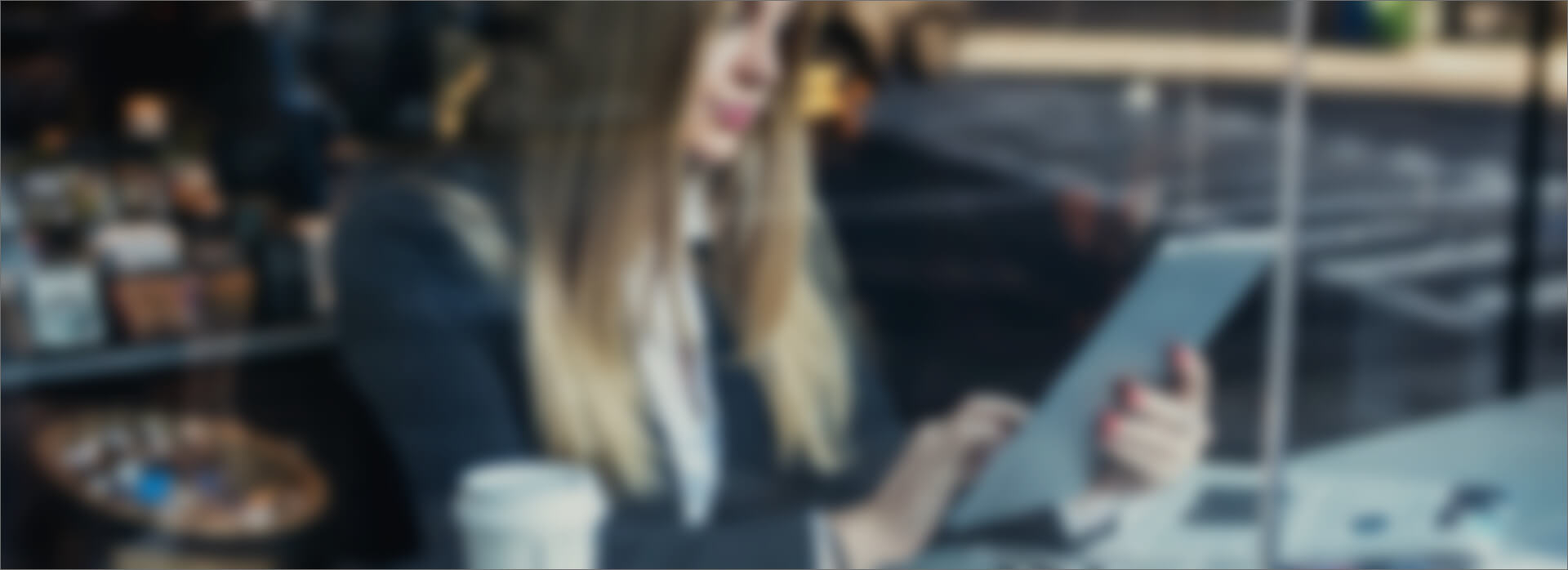
 Par Christophe Grison, Avocat d’affaires, FIDAL
Par Christophe Grison, Avocat d’affaires, FIDAL