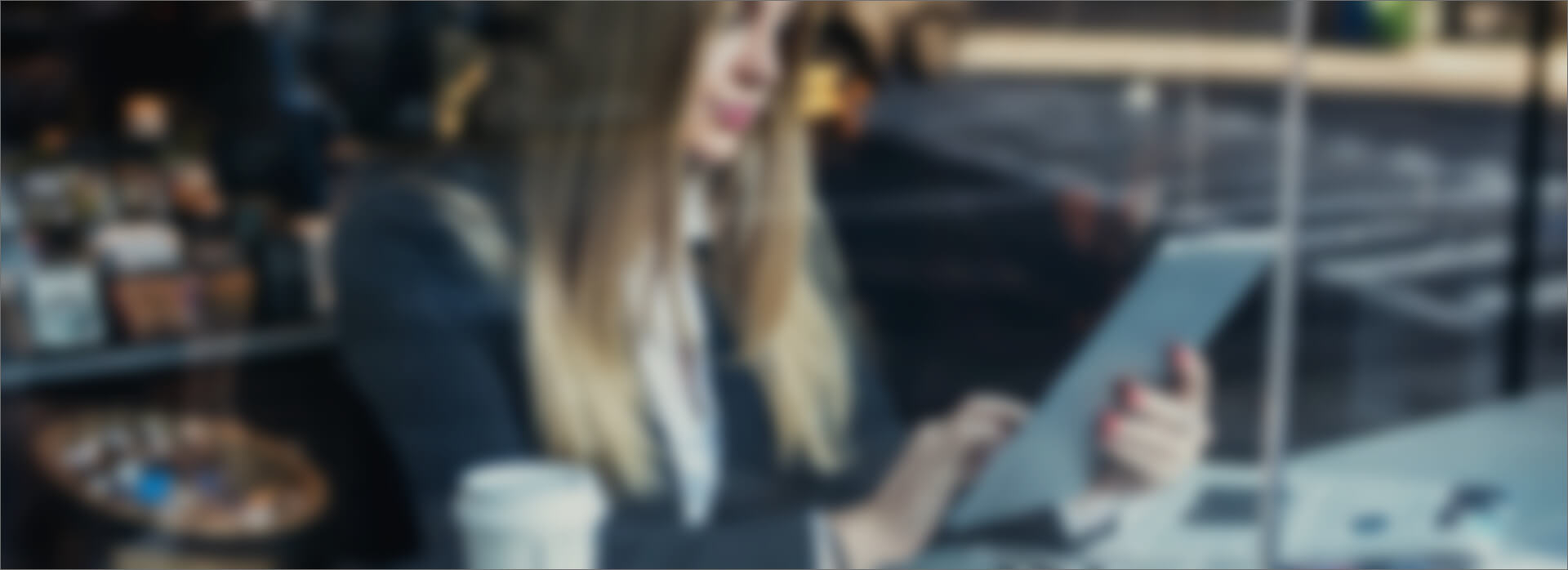La cour d’appel de Poitiers vient de refuser la requalification d’un contrat de licence de marque en contrat de franchise. Pour elle, mettre à disposition une enseigne, un savoir-faire, une formation et une assistance pour le choix des produits ne suffit pas à caractériser une relation de franchise. Par ailleurs, le licencié dont la résiliation du contrat est jugée fautive, est débouté de sa demande de nullité.
 La cour d’appel de Poitiers a tranché il y a peu un litige portant, entre autres, sur la nature du contrat liant les deux partenaires. Dans cette affaire, le partenariat est signé fin 2014 pour dix ans et le point de vente ouvert début 2015, après rachat d’une unité du réseau auprès d’un de ses membres.
La cour d’appel de Poitiers a tranché il y a peu un litige portant, entre autres, sur la nature du contrat liant les deux partenaires. Dans cette affaire, le partenariat est signé fin 2014 pour dix ans et le point de vente ouvert début 2015, après rachat d’une unité du réseau auprès d’un de ses membres.
Le contrat se présente comme une licence de marque, mettant à la disposition du licencié une enseigne, un savoir-faire transmis lors d’une formation initiale de trois semaines et une assistance pour le choix des produits et accessoires à mettre en vente. Il est signé en contrepartie d’un engagement d’approvisionnement exclusif auprès de la tête de réseau (ou de ses fournisseurs) et du paiement de redevances.
Les affaires ne marchent guère pour ce point de vente et en septembre 2016, le licencié cesse de payer ses redevances et résilie son contrat. Il tente par la suite de poursuivre son activité mais doit déposer le bilan et se retrouve en 2019 placé en liquidation judiciaire.
Le licencié demande la nullité de son contrat… de franchise et non de licence de marque, selon lui
Devant la cour d’appel de Poitiers, le licencié affirme que les trois composantes du contrat de franchise – savoir-faire, assistance technique et commerciale et signes distinctifs de clientèle – sont bien réunies dans son cas et qu’il ne s’agit donc pas d’une vraie licence de marque.
Et il ajoute que, précisément, ce contrat de franchise est dépourvu de cause car le savoir-faire n’y est en réalité ni substantiel, ni spécifique et qu’aucun manuel opératoire n’a été délivré. La tête de réseau n’a pas non plus, selon lui, transmis avant la signature du contrat un DIP conforme à la loi (pas d’état du marché local ni de comptes annuels du « franchiseur »).
En conséquence, il demande que le contrat soit requalifié en contrat de franchise et que sa nullité en soit prononcée pour absence de cause et vice du consentement.
Au cœur de la nature du contrat : celle du savoir-faire, selon les juges
Contrairement au tribunal de commerce, la cour d’appel de Poitiers déboute le licencié sur la nature du contrat.
Si celui-ci fait bien référence à un savoir-faire résultant de l’expérience de la tête de réseau, il n’a pas, selon les magistrats, toutes les qualités indiquées par le droit européen de référence pour la franchise : « Il ne peut être considéré que les conseils sur le stock à constituer, son adaptation au milieu local, la préparation de l’ouverture (du point de vente) et l’attitude à adopter face aux clients puissent constituer un savoir-faire substantiel ou secret », écrivent les juges. « Il s’agit en réalité d’une simple formation à la technique de vente, à la gestion des stocks, non spécifique et que le contractant aurait pu acquérir lui-même par l’expérience. »
Ils affirment que, selon la jurisprudence, « lorsque le « savoir-faire« se limite à la sélection des produits et des fournisseurs par le concédant, il s’agit d’éléments sans originalité que n’importe quel professionnel peut acquérir seul ».
Par ailleurs, les signataires du contrat « n’avaient pas convenu que le savoir-faire devait faire l’objet d’un document détaillé et opératoire (…) comme il est d’usage en matière de contrat de franchise. » De même, la tête de réseau « ne s’est pas engagée à délivrer une assistance continue ».
Pour la cour, il s’agit donc bien d’un « contrat de licence de marque avec clause d’exclusivité » et pas d’un contrat de franchise.
Pas de nullité du contrat pour absence de cause ou vice du consentement, et pas d’indemnité
La cour balaye les autres arguments du licencié. Même s’il n’y avait pas eu de formation, raisonnent les juges, cela n’aurait pas été une cause de nullité.
Quant au vice du consentement, il n’est pas prouvé à leurs yeux, même si le DIP était incomplet. Le licencié a en effet racheté une affaire dont il avait pu, selon eux, évaluer les mauvais résultats. La nullité du contrat ne peut donc être accordée.
De même, les manquements contractuels listés par le licencié (sur la formation, « l’absence de politique tarifaire », le « caractère obsolète du catalogue » et les problèmes d’approvisionnement qui l’auraient contraint à se fournir auprès d’un tiers) ne sont, aux yeux de la cour, « pas démontrés ». Sa demande de compensation du préjudice à hauteur de 30 000 € lui est ainsi refusée.
Résiliation fautive du licencié selon la cour, mais pas de dommages et intérêts à verser
En revanche, la résiliation du contrat par le licencié est bien jugée « fautive » par la cour, dans la mesure où il ne l’a pas fait précéder, comme une clause le prévoyait, d’une mise en demeure de son partenaire. Et qu’il ne lui a pas non plus adressé de plainte sur son exécution pendant la durée de leur relation.
Toutefois, dans la mesure où le texte de la convention était muet sur le sujet, la cour déboute la tête de réseau de sa demande de paiement des redevances jusqu’au terme prévu du contrat (près de 30 000 €).
Elle écarte aussi sa demande d’indemnités de 80 000 € réclamée pour résiliation fautive et non-respect de la clause de non-concurrence post-contractuelle de trois ans sur l’ensemble du territoire national. « Parce qu’il n’est pas démontré que la société (du licencié) ait poursuivi son activité en violant la clause de non-concurrence ».
Le contrat de licence de marque est donc validé et la cour sanctionne une faute du licencié, mais, de fait, sans ajouter de pénalités financières à sa liquidation judiciaire.