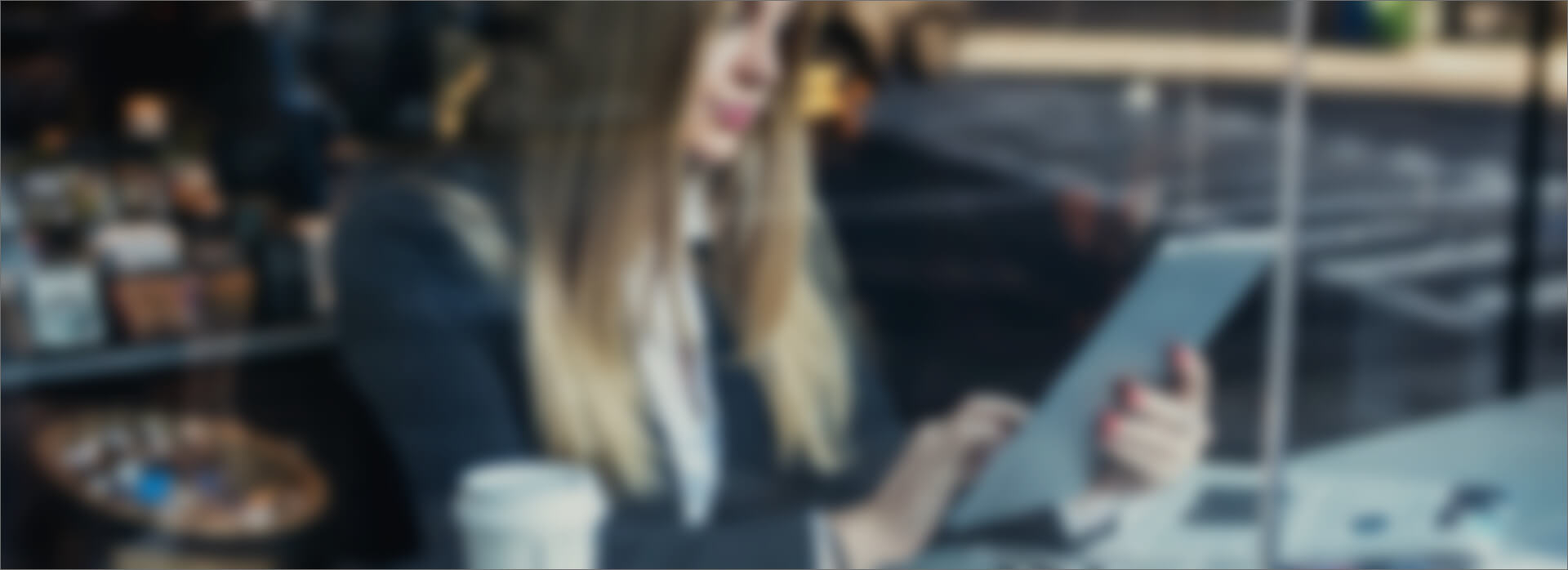L’adhérente d’un groupement d’achats estimait avoir été trompée sur le potentiel de son projet. La cour d’appel de Rennes lui donne en partie raison. Tout en considérant que son contrat n’était pas de la franchise et n’entrait pas, de toute façon, dans le champ de la loi Doubin sur l’information précontractuelle.

Dans cette affaire, le contrat est signé en avril 2009 et l’activité démarre en mai 2010. Selon les prévisions transmises par l’enseigne, la partenaire doit la première année atteindre un chiffre d’affaires de plus de 500 000 €. Or, son premier exercice plafonne à 155 149 €. En décembre 2011, sa société est placée en redressement puis, en février 2012, en liquidation judiciaire.
Assignant sa tête de réseau en justice, l’adhérente réclame la requalification de son contrat d’adhésion en contrat de franchise ainsi que l’annulation de la disposition indiquant que la convention conclue n’entrait pas dans le champ de la loi Doubin sur l’information précontractuelle.
Pour elle, la tête de réseau n’a pas respecté les obligations de cette loi et, en lui transmettant des chiffres d’affaires prévisionnels erronés, a vicié son consentement. Elle demande donc pour elle-même l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis tandis que le liquidateur de sa société sollicite de son côté le remboursement des droits d’entrée, redevances et de toutes les créances déclarées au passif.
En juin 2017, le tribunal de commerce de Nantes déboute le liquidateur mais condamne la tête de réseau à rembourser à l’ex-adhérente du groupement les sommes correspondant à son apport personnel en capital, aux investissements réalisés à titre personnel, aux sommes versées sur son compte courant d’associée, et à celles remboursées à la banque en sa qualité de caution de l’emprunt contracté par sa société. Un total de l’ordre de 240 000 €.
Pour la cour, il ne s’agit pas d’un contrat de franchise, car il n’y a pas eu transmission d’un savoir-faire
Saisie par la tête de réseau, la cour d’appel de Rennes écarte d’abord la requalification en contrat de franchise.
Certes, il y a bien eu mise à disposition d’une enseigne et engagement contractuel à une « politique commerciale commune », notamment publicitaire.
Il y a eu également assistance avant ouverture pour la recherche du local et la définition des plans du magasin ; assistance encore pendant le contrat « sur le plan marketing, juridique, commercial, comptable et fiscal avec dispense d’une formation ». Le groupement, qui s’était engagé par ailleurs à des visites régulières, est même intervenu auprès du bailleur pour tenter de renégocier le loyer de sa partenaire.
Mais il ne s’agit pas d’une franchise parce qu’il n’y a, selon les juges, « pas de savoir-faire particulier substantiel, identifié et secret ». La transmission d’un « concept » ne suffisant pas à prouver que le groupement aurait transmis « une façon de travailler spécifique et inhérente à ce concept ».
Les exigences de l’enseigne concernant l’aménagement intérieur du magasin pas plus que les « meilleures solutions marketing et publicitaires » qui aurait été apportées à l’adhérente (mais qu’elle n’a pas détaillées) ne suffisent pas davantage à convaincre les juges. Pour eux, « le contrat conclu consiste en une simple adhésion à un groupement de personnes qui, affiliées à une même enseigne, mettent en commun leurs forces commerciales pour négocier au meilleur prix l’achat de produits sélectionnés auprès de fournisseurs référencés. »
La loi Doubin ne s’applique pas selon les juges, car l’adhérente conservait la liberté de s’approvisionner ailleurs pour 30 % de ses achats
La cour d’appel écarte également l’affirmation selon laquelle le contrat conclu entrait dans le champ de la loi Doubin sur l’information précontractuelle (texte devenu l’article L 330-3 du code de commerce).
Les magistrats rappellent que cet article de loi s’applique à tous les contrats (de franchise ou non) qui « associent mise à disposition d’un nom commercial, d’une marque ou d’une enseigne, et soumission à un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité. »
Or, selon eux, le contrat litigieux n’est pas concerné par cet engagement d’exclusivité, puisqu’il prévoit seulement que l’adhérent s’engage « à suivre les recommandations de la centrale à hauteur d’un minimum de 70 % de ses achats auprès de fournisseurs proposés par le groupement ».
« L’adhérente conservait (donc) la liberté de s’approvisionner jusqu’à 30 % (soit près d’un tiers) de ses achats auprès des fournisseurs de son choix, y compris en dehors du réseau. Ainsi, cette liberté, même restreinte, demeurait suffisamment importante, relativement parlant, pour priver le contrat de son caractère ‘d’exclusivité’ voire de ‘quasi-exclusivité’ au sens de l’article L 330-3 du code de commerce. » Il est vrai que la quasi-exclusivité commence plutôt à 80 % d’achats imposés si l’on prend en référence les textes européens…
L’enseigne n’était donc, selon la cour, « pas tenue de satisfaire aux exigences de l’information précontractuelle telle qu’elle est définie (par la loi) ». Résultat : la partenaire ne peut pas « se prévaloir » de ne pas avoir reçu cette information. Elle ne « peut pas en déduire » que son consentement a été vicié et que, « dès lors », son contrat serait nul.
Selon la cour, la tête de réseau a transmis des informations dépourvues de sérieux et c’est une faute selon le droit commun des contrats

Or ce n’est pas le cas, selon les juges, de l’état du marché local fourni par la tête de réseau qui « n’hésite pas à envisager que le magasin à ouvrir puisse réaliser un chiffre d’affaires potentiel de de 2 264 712,27 €. »
De même, le « dossier prévisionnel d’activité », également transmis par l’enseigne, « quoique plus classique, n’est guère plus sérieux » avec ses 546 000 € prévus pour l’exercice 2010-2011 alors que « la très grande majorité des points de vente à l’enseigne ont réalisé (dans la même période) des chiffres d’affaires très inférieurs. »
En outre, la partenaire en litige « n’est pas la seule à avoir souffert de l’optimisme commercial de la tête de réseau puisque son propre successeur dans les mêmes locaux a dû également fermer le magasin deux ans plus tard » et qu’aucun autre n’a semble-t-il rouvert ensuite, l’emplacement n’étant apparemment pas propice.
Pour la cour, il y a donc bien eu, de la part de l’enseigne, transmission d’informations dépourvues de sérieux. Et l’écart est tel entre ses prévisions et la réalité que la rentabilité était impossible pour sa partenaire.
Pas de vice du consentement, pas de nullité du contrat, mais la tête de réseau doit verser 90 000 € en compensation des préjudices qu’elle a infligés
Les magistrats ne considèrent pas, toutefois, que le consentement de l’ex-adhérente a été vicié. A leurs yeux, elle « n’en apporte pas la preuve ».
D’abord parce que, contrairement aux termes même du contrat qui l’y incitait, « elle n’a fait procéder à aucune étude » de faisabilité de son projet et s’est « contentée des données transmises » par l’enseigne. Mais aussi parce qu’« il n’est même pas certain qu’en étant informée de l’absence de sérieux des prévisions reçues, voire du caractère improbable du chiffre d’affaires annoncé, elle aurait renoncé à souscrire le contrat en cause. »
Le contrat n’est donc pas annulé. En revanche, conclut la cour, la tête de réseau « a commis une faute engageant sa responsabilité civile extracontractuelle et, par application des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil, doit réparer l’ensemble des préjudices qui en sont résultés ».
La cour d’appel de Rennes accorde ainsi 10 000 € à titre personnel à l’adhérente en compensation du préjudice moral qu’elle a subi. Mais refuse ses autres demandes : plus de 100 000 € de « préjudice financier » pour ses investissements et apports en capital perdus et 20 000 € pour sa « perte de chance d’exploiter un concept rentable ».
Quant au liquidateur, il obtient 80 000 € « en réparation du préjudice subi par suite du manquement de la tête de réseau à son obligation d’information précontractuelle ». En raison de la « perte de chance » que la société partenaire avait « de ne pas signer ce contrat » et « de ne pas s’exposer à des dépenses incompressibles » de l’ordre de 90 000 € d’emprunt et plus de 70 000 € de loyers.
Le message principal qui se dégage de cet arrêt est clair : ce n’est pas parce qu’une tête de réseau ne fait pas de franchise et n’exige pas d’exclusivité ou de quasi-exclusivité (d’approvisionnement en l’occurrence) qu’elle est pour autant exonérée de respecter ses futurs partenaires. Si elle leur transmet des informations en matière de prévisionnel, elle doit veiller à ce qu’elles soient sérieuses.