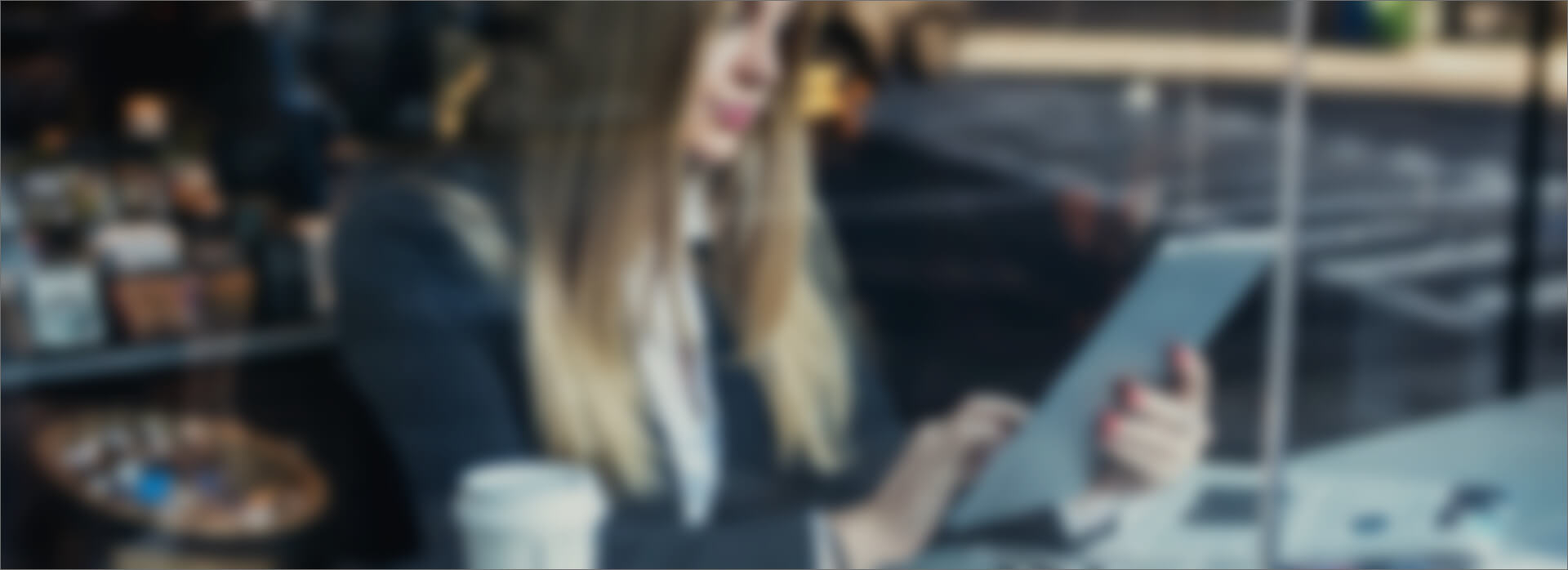Un franchisé signe son contrat en 2010. Mais des difficultés imprévues retardent son projet et il n’ouvre son établissement qu’en 2012, alors même que le petit réseau qu’il a rejoint enregistre des départs. Lui-même est mis en échec. Estimant que son franchiseur a vicié son consentement, il l’assigne en justice. La cour d’appel de Paris le déboute.
 L’arrêt du 19 mai 2021 rendu par la cour d’appel de Paris le démontre une nouvelle fois : il ne suffit pas à un franchisé d’affirmer que son ex-partenaire a vicié son consentement pour obtenir la nullité de son contrat.
L’arrêt du 19 mai 2021 rendu par la cour d’appel de Paris le démontre une nouvelle fois : il ne suffit pas à un franchisé d’affirmer que son ex-partenaire a vicié son consentement pour obtenir la nullité de son contrat.
Dans ce litige, tout se passe au début apparemment dans les normes. En mars 2009, le futur franchisé dépose un dossier de candidature afin de rejoindre un réseau qui compte alors douze unités dont trois en propre. Un mois plus tard, en avril 2009, l’enseigne lui remet un DIP (Document d’information précontractuel) et des éléments chiffrés afin de calculer ses prévisions d’activité.
Mais les recherches prennent du temps et le candidat ne signe son contrat de franchise qu’en novembre 2010 pour un emplacement d’une cinquantaine de mètres carrés dans un centre commercial. Et là, ça se corse : courant 2011, le centre lui refuse l’implantation qu’il a choisie et lui propose à la place une surface de 100 m², près de deux fois plus grande. Sollicités, les banquiers lui opposent plusieurs refus.
Il ouvre finalement son établissement en mai 2012 et dès son premier exercice, sa société connaît une perte d’exploitation qui perdure en 2013. Elle est placée en liquidation judiciaire en février 2014.
Le franchisé reproche au franchiseur de l’avoir sciemment laissé s’engager dans un projet voué à l’échec
Pour le franchisé, qui s’est adressé à la justice en septembre 2013, son consentement a été vicié. Le contrat doit donc être annulé et d’importantes sommes versées à sa société franchisée ainsi qu’à lui-même.
Le franchisé reproche notamment à son « ex » de l’avoir « sciemment laissé s’engager sur un projet qui était dès l’origine voué à l’échec, puisqu’il n’a même pas réussi à atteindre le niveau d’activité prévu » sur le local initial de 50 m². Il estime que le franchiseur « ne pouvait, de bonne foi, valider son prévisionnel » de 2011 concernant l’emplacement de 100 m², alors qu’il « savait parfaitement que ces chiffres étaient totalement irréalistes au regard de ceux enregistrés tant par les succursales que par les unités franchisées en 2008 et 2009 ».
A l’appui de ces affirmations, il évoque également les sorties de réseau de plusieurs franchisés intervenues en 2012. Ce qui, quand une enseigne ne regroupe au total que moins de dix partenaires, est plutôt significatif.
Pour les juges, les informations transmises en 2009 n’étaient pas trompeuses
Après l’avoir examiné, les magistrats estiment que le DIP transmis en avril 2009 était conforme aux exigences de la loi.
Concernant les difficultés rencontrées, selon le plaignant, par au moins trois franchisés sur neuf et le fait que le franchiseur se serait volontairement abstenu de lui en faire part, la cour d’appel estime « qu’aucune pièce versée aux débats » ne prouve que ces franchisés connaissaient effectivement « des difficultés significatives nécessitant une information particulière voire une mise en garde du franchiseur » au moment de la « souscription du contrat en juin 2009 ».
Les juges écrivent encore qu’il « ne peut non plus être reproché au franchiseur de n’avoir pas mentionné dans le DIP remis en 2009 les sorties de réseau intervenues en 2012. »
De même, le prévisionnel de 2011 n’a pas pu, selon la cour, vicier le consentement du franchisé

S’agissant du deuxième projet (de 2011 sur 100 m²), la cour relève que le franchiseur a précisément « émis des réserves » sur le prévisionnel du candidat. Et que, de toute manière, le franchisé « ne peut pas prétendre qu’il y a eu vice du consentement avec des prévisions élaborées un an après la signature du contrat. »
Pour la cour d’appel de Paris, le franchisé « échoue à démontrer » que son consentement a été vicié. Son contrat n’est pas annulé.
Le franchiseur n’a-t-il pour autant aucune responsabilité dans l’échec de son partenaire ?
Plusieurs questions se posent cependant. Le franchiseur n’aurait-il pas dû transmettre à son candidat un nouveau DIP avant la signature du contrat en novembre 2010, dix-neuf mois après le précédent ? N’aurait-il pas dû déconseiller à son partenaire de s’engager sur un emplacement deux fois plus grand que celui pour lequel il avait signé son contrat, ce qui allait forcément compliquer voire compromettre sa rentabilité ? N’aurait-il pas dû, en 2011, lui transmettre pour son prévisionnel des données chiffrées actualisées, tenant compte des difficultés rencontrées par trois de ses franchisés sur neuf ? N’aurait-il pas dû d’ailleurs, faire état de ces difficultés, qu’il ne pouvait ignorer en 2011 et qui ont abouti en 2012 à des sorties de réseau pour cause d’échec ?
L’issue de la procédure aurait-elle été différente si la justice avait été saisie pour manquements du franchiseur à son devoir d’assistance entre la signature du contrat et l’ouverture de l’établissement franchisé ? Une chose est sûre en tout cas : le vice du consentement ne peut être invoqué avec succès que pour des faits survenus, et prouvés, avant la signature du contrat, pas après. Même s’il s’agit de prévisions concernant la rentabilité de ce qui n’est encore qu’un projet du franchisé…