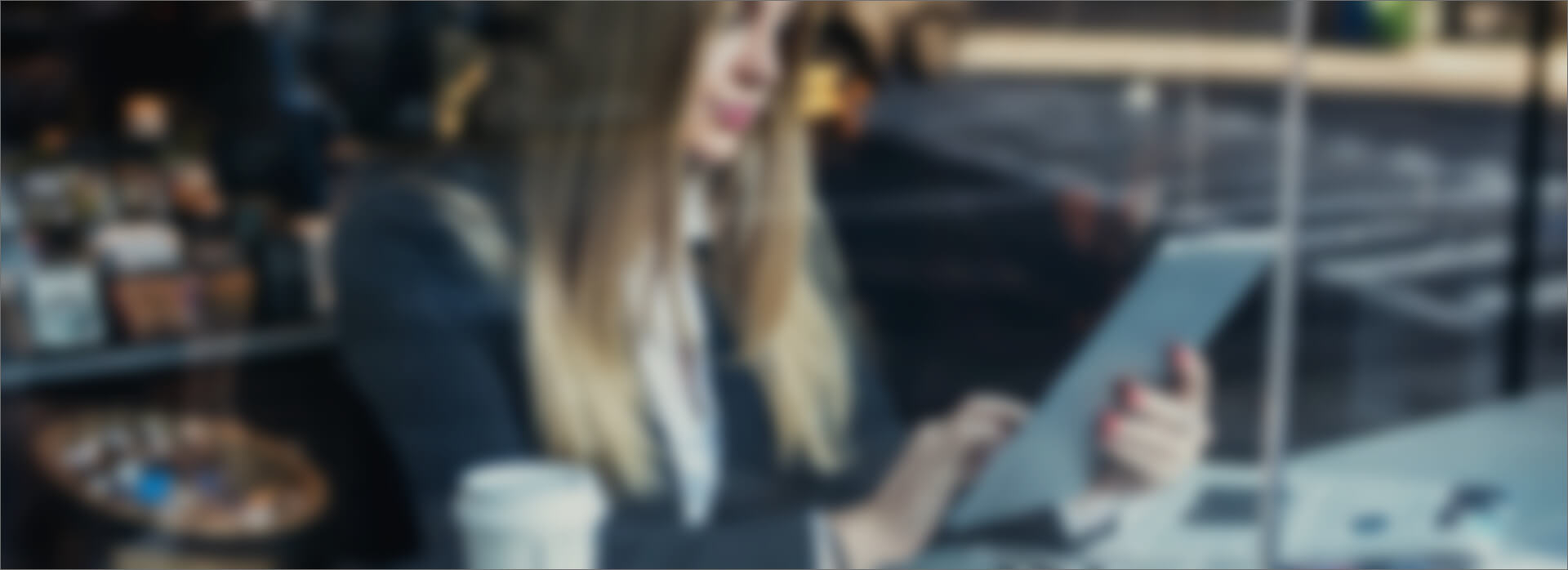Deux franchisés associés s’étant acquittés de leur droit d’entrée à la signature de leur contrat ne parviennent pas à obtenir leur financement et renoncent à leur projet. Devant le refus du franchiseur de les rembourser, ils l’assignent en justice. Ils sont déboutés.

Dans ce litige, le contrat de franchise et signé et le droit d’entrée de 18 600 € TTC réglé en mai 2018.
Le franchiseur transmet à ses partenaires ses manuels opératoires concernant la phase de pré-ouverture et le fonctionnement ultérieur de l’établissement franchisé.
Les deux franchisés signent une promesse de bail en juillet, puis sollicitent l’architecte préconisé par l’enseigne et suivent en septembre les 4 jours de la formation initiale qu’elle leur propose.
Mais leur projet s’arrête là.
En janvier 2019, ils expliquent par courrier à leur partenaire qu’ils se sont « heurtés à des refus de plusieurs banques pour (leur) financement ». Et réclament « à l’amiable » le remboursement de leur droit d’entrée, une somme qui représentent selon eux les économies de leur jeune vie.
Ne parvenant pas à un accord avec le franchiseur – qui leur propose une variante moins coûteuse de son concept et six mois d’exclusivité supplémentaires -, ils l’assignent en justice. Déboutés en première instance par le tribunal de commerce de Bobigny, ils font appel.
Les franchisés étaient des « professionnels » selon la cour, pas des « consommateurs »
Devant la cour d’appel de Paris, les franchisés avancent plusieurs arguments.
D’abord, affirment-ils, en tant que candidats franchisés, ils n’étaient pas des professionnels. La preuve : ils n’ont pas ouvert d’établissement, pas fait d’actes de commerce. Ils sont donc de simples consommateurs au sens du code de la consommation. (Ils peuvent donc valablement demander le remboursement d’une somme conservée selon eux par le vendeur de manière abusive.)
Ce n’est pas l’avis des magistrats.
Pour eux, les franchisés ont signé leur contrat « tant en leur nom personnel qu’en tant que représentants d’une société en cours de constitution ». Ils « répondent donc » à la définition de « professionnels » telle qu’elle apparaît dans le code de la consommation en vigueur lors de la signature du contrat, à savoir « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel. »
Le fait que les franchisés n’aient pas exploité l’établissement prévu « ne saurait, en lui-même », ajoutent les juges, « les décharger de leurs responsabilités de professionnels ».
Il n’y a pas, selon la cour, de « déséquilibre significatif », même s’il s’agit bien d’un « contrat d’adhésion »…
Les franchisés affirment ensuite que le contrat de franchise qui leur a été proposé est un « contrat d’adhésion » dont aucune clause n’a été négociable.
En particulier, l’article 10.1 du contrat – qui prévoit que le droit d’entrée ne sera jamais restitué, quelle que soit l’issue du contrat, même en cas d’inexécution ou de résiliation par le franchiseur – crée, selon eux, un déséquilibre significatif entre les parties et doit être considéré comme une clause abusive et donc non écrite.
La cour d’appel reconnaît que le contrat en litige est un « contrat d’adhésion en ce qu’il comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par le franchiseur ».
Cependant, les magistrats rappellent que, selon l’article 1171 du code civil en vigueur au moment de la signature du contrat, « dans un contrat d’adhésion (…), l’appréciation du déséquilibre significatif ne (peut porter) ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ».
Pour les juges, elle ne peut donc, dans ce litige, pas porter sur l’adéquation du droit d’entrée à la prestation, en l’occurrence « la transmission du savoir-faire par le franchiseur, notamment dans le cadre de la formation initiale et l’exclusivité accordée au franchisé ».
Pour la cour, la demande de restitution du droit d’entrée de 18 600 € ne peut, ici, « pas être fondée » sur le déséquilibre significatif.
Il n’y avait pas d’interdépendance entre le contrat de franchise et un éventuel contrat de prêt, selon les juges

Ce n’est pas l’avis des magistrats qui s’appuient sur l’article 1186 du code civil définissant dans quels cas un contrat peut être caduc.
Ils relèvent notamment que, dans le contrat de franchise, « aucune stipulation » ne suspendait son exécution à l’obtention d’un prêt bancaire. Et concluent, après une argumentation détaillée, à l’absence d’interdépendance entre le contrat de franchise et « un éventuel » contrat de prêt.
Le jugement de première instance déboutant les franchisés de leurs demandes est donc confirmé. Leur droit d’entrée ne leur sera pas remboursé.
Pas de sanction pénale pour rupture anticipée du contrat
La cour ne suit toutefois pas le franchiseur dans sa demande de sanction pénale pour cause de rupture anticipée. Une sanction à hauteur de plus de 83 000 € correspondant, selon son calcul, aux redevances qui auraient été dues si ce contrat de 7 ans s’était poursuivi jusqu’à son terme.
Contrairement à ce qui était prévu au contrat, le franchiseur n’a en effet pas prévenu par lettre recommandée de son intention de faire jouer cette clause pénale. Quant aux franchisés, ils n’ont pas formellement acté de rupture dans leur courrier de janvier 2019.
Ils doivent en revanche rendre au franchiseur ses manuels de savoir-faire et autres matériels reçus pour exploiter la franchise.